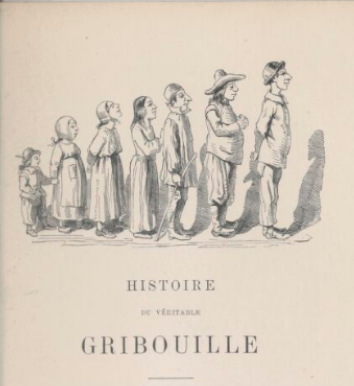La fiction dépeint un Wagner passionné et obsédé par son idée fixe de rencontrer Beethoven. D'où l'aspect répétitif de toute une partie de la pièce. S'ajoute à cela le duel qui l'oppose à un musicien amateur anglais qui lui aussi souhaite rencontrer le maître.
La surprise vient de l'aspect caricatural, et ouvertement ridicule de cette quête, qui va pourtant aboutir sur quelque chose de plus sérieux. Or, l'humour se trouve déjà dans la nouvelle de Wagner, racontant cette rencontre, qui n'a dans la réalité pas eu lieu.
Cette nouvelle, écrite par un Wagner alors âgé de 27 ans, se termine donc par un échange avec Beethoven, ce dernier passant le flambeau à son disciple en énonçant quelques idées que Wagner adoptera dans sa propre écriture.
Pour se payer le voyage à Vienne, le jeune homme se retrouve obligé d'écrire de la musique alimentaire.
La réalisation, comme l'adaptation, accentue l'aspect humoristique de la nouvelle. Parmi les galops alimentaires composés, on entend la fameuse chevauchée, qui n'était alors pas encore composée...
L'interprétation aussi n'y va pas de main morte, et le duel entre Wagner et l'anglais ne manque pas de lourdeur. Cette lourdeur vient s'opposer ouvertement à toute la scène finale, la rencontre Beethoven / Wagner, durant laquelle le discours sur l'esthétique musicale prend le pas sur la caricature.
Cette fiction date de 1993 : ajouter que l'interprétation est de qualité, et que la réalisation impeccable est superflu. C'était encore le quotidien des fictions de France Culture...
« Pauvreté, dure indigence, compagne habituelle de l’artiste allemand, c’est à toi qu’en écrivant ici ces pieux souvenirs, je dois adresser mon invocation première. Je veux te célébrer, toi, ma patronne fidèle, qui m’as suivi constamment en tous lieux ; toi qui, de ton bras d’airain, m’as préservé des vicissitudes d’une fortune décevante, et qui m’as si bien abrité contre les rayons enivrants de son soleil, grâce au nuage épais et sombre dont tu as toujours voilé à mes regards les folles vanités de ce monde. Oui, je te remercie de ta sollicitude maternelle ; mais ne pourrais-tu pas désormais la pratiquer en faveur d’un nouveau protégé ? car la curiosité m’aiguillonne, et je voudrais, ne fût-ce que pour un jour, essayer de l’existence sans ta participation. Pardonne, austère déesse, à cette velléité d’ambition ! Mais tu connais le fond de mon cœur, et tu sais quelle dévotion sincère j’aurai toujours pour ton culte, alors même que je cesserais d’être l’objet favori de ta prédilection. Amen ! »
L’adoption de cette prière quotidienne doit vous dire assez que je suis musicien, et que l’Allemagne est ma patrie. Une ville de moyenne importance me donna le jour. Je ne sais quelles étaient les vues de mes parents sur ma condition à venir ; mais ce que je me rappelle, c’est qu’un soir, ayant entendu une symphonie de Beethoven, j’eus dans la nuit un accès de fièvre, je tombai malade, et qu’après mon rétablissement je devins musicien. Cette circonstance peut expliquer la préférence que je donnai constamment dans la suite aux œuvres de Beethoven, quelque belle musique que j’aie maintes fois entendue. C’était pour moi une affection, une idolâtrie à part. Ma plus vive jouissance fut de me plonger dans l’étude intime, approfondie de ce puissant génie, jusqu’à ce que je crus m’être identifié pour ainsi dire avec lui, jusqu’à ce que mon esprit nourri d’inspirations de plus en plus sublimes me parût être devenu une parcelle de ce rare et merveilleux esprit, jusqu’à ce qu’enfin j’arrivai à cet état d’exaltation que bien des gens traitent de démence.
Folie bien tolérable pourtant, et bien inoffensive. Cela ne me procurait qu’un pain fort sec et une boisson fort crue ; car on ne s’enrichit pas en Allemagne à courir le cachet. Après avoir vécu de la sorte assez longtemps dans ma mansarde, je vins un jour à penser que le grand artiste, objet de ma profonde vénération, vivait encore, et j’eus peine à m’expliquer comment cette idée ne m’était pas venue plus tôt. Le fait est que jamais jusque-là je ne m’étais représenté Beethoven sous une forme humaine pareille à la nôtre, et soumis aux besoins et aux appétits de la nature. Et cependant il existait, il vivait à Vienne, et dans une condition à peu près semblable à la mienne. Dès lors je n’eus plus un instant de repos ; toutes mes pensées, tous mes désirs étaient dirigés vers un seul but : voir Beethoven. Nul musulman n’entreprit jamais le pèlerinage au tombeau du Prophète avec plus de foi ni d’ardeur que m’en inspirait mon projet. Mais comment m’y prendre pour le mettre à exécution ? C’était pour moi une grande affaire que d’aller à Vienne, car il fallait de l’argent pour le voyage, et, pauvre diable que j’étais, je gagnais à peine de quoi subvenir aux plus pressantes nécessités. Il fallait donc avoir recours à des moyens exceptionnels pour me procurer les fonds nécessaires, et ce fut dans ce but que j’allai proposer à un éditeur plusieurs sonates pour le piano que j’avais composées sur le modèle de celles de Beethoven. Le marchand me démontra en peu de mots que je n’étais qu’un fou avec mes sonates, et il me donna le conseil, si je voulais avec le temps gagner quelques écus avec ma musique, de me faire d’abord une petite réputation avec des galops et des pots-pourris. Je frémis d’indignation ; mais le désir passionné qui m’obsédait fit taire tous mes scrupules, et je me mis à composer des galops et des pots-pourris. Seulement je m’abstins dans l’intervalle de jeter un seul regard sur les partitions de Beethoven, car j’aurais cru commettre une profanation honteuse. Mais hélas ! je ne gagnai rien à avoir sacrifié ainsi mon innocence : l’honnête éditeur me déclara qu’il était indispensable de jeter préalablement les fondements de ma renommée par une ou deux publications gratuites. Je restai pour la seconde fois interdit, et je me retirai, le désespoir dans l’âme. Mais l’excès même du dépit et de la rage me devint propice, car je composai dans cet état plusieurs galops formidables qui me valurent enfin quelques honoraires, et je crus enfin en avoir assez recueilli pour me mettre en route. Deux ans s’étaient écoulés pourtant, et je tremblais sans cesse que Beethoven ne vînt à mourir avant que j’eusse fondé mon crédit sur le mérite de mes galops et de mes pots-pourris. Mais, Dieu soit loué, il avait attendu cette heure mémorable. Ô saint Beethoven ! pardonne-moi cette renommée indigne que je n’ai briguée que pour conquérir le bonheur et la gloire de te connaître.
Quelle fut ma joie en me voyant libre enfin d’accomplir mon projet ! quel fut mon bonheur en faisant mes préparatifs de départ ! Ce fut avec une sainte émotion que je franchis la porte de la ville pour me diriger vers le Sud. J’aurais volontiers pris place dans une diligence, non que je redoutasse la fatigue d’un voyage à pied (quelle épreuve m’eût paru trop pénible pour voir mon souhait exaucé !), mais c’est que je serais ainsi arrivé plus vite à Vienne. Malheureusement, mon renom en qualité de compositeur de galops n’était pas encore devenu assez célèbre pour me permettre une telle commodité. Cette réflexion m’inspira une résignation à toute épreuve, et je me félicitai d’avoir déjà surmonté tant d’obstacles. De quels rêves enchanteurs ne se berçait pas mon imagination ! Un amoureux revenant après une longue absence auprès de sa bien-aimée ne sent pas plus délicieusement battre son cœur. Je traversai ainsi les belles campagnes de la Bohème, ce pays privilégié des joueurs de harpe et des chanteurs nomades. Dans un petit bourg, je fis la rencontre d’une de ces nombreuses troupes de musiciens ambulants, orchestre mobile composé d’un violon, d’une basse, d’une clarinette, d’une flûte et de deux cors, sans compter une harpiste et deux chanteuses pourvues d’assez jolies voix. Pour quelques pièces de monnaie, ils exécutaient des airs de danse ou chantaient quelques ballades, et puis ils allaient plus loin recommencer le même manège. Un jour, je les trouvai de nouveau sur mon chemin, campés à l’abri d’un quinconce qui bordait la grande route, et occupés à prendre un frugal repas. Je me présentai à l’escouade comme exerçant le même métier qu’eux, et nous fûmes bientôt amis ensemble. Je m’informai timidement si leur répertoire de contredanses contenait quelques-uns des galops dont j’étais l’auteur ; mais, Dieu merci ! ils n’en avaient point entendu parler, et leur ignorance me combla de joie. — Mais vous jouez aussi, leur dis-je, d’autre musique que des contredanses ? — Sans doute, me répondirent-ils, mais seulement entre nous, et non pas devant le monde. En même temps ils déballèrent leur musique, et mon premier coup d’œil tomba sur le grand septuor de Beethoven. Je leur demandai avec surprise si c’était là un de leurs morceaux favoris. — Pourquoi donc pas ? répliqua le plus âgé de la troupe ; si Joseph n’avait pas mal à la main, et qu’il pût remplir la partie du premier violon, nous nous donnerions ici même ce plaisir. Dans un transport d’ivresse, je m’emparai vivement du violon de Joseph, en promettant de faire de mon mieux pour le remplacer, et nous entreprîmes aussitôt le septuor.
Quel ravissement d’entendre là, à ciel ouvert, au bord d’une grande route de la Bohême, ce magnifique ouvrage exécuté par une bande de musiciens ambulants avec une pureté, une précision et une profondeur de sentiment telles qu’on les trouve rarement chez les virtuoses les plus huppés. Grand Beethoven ! ce fut vraiment un sacrifice digne de ton génie auquel je participai. Nous étions arrivés au finale quand une chaise de poste élégante, que nous n’avions pu apercevoir à cause du coude de la chaussée, s’arrêta silencieusement en face de nous. Un jeune homme d’une taille excessivement élancée, et d’un blond non moins exagéré, était étendu sur les coussins, et prêtait à nos accords une oreille attentive ; puis il tira de sa poche un agenda pour y consigner quelques notes, et après avoir jeté devant nous une pièce d’or, il continua sa route en adressant à son domestique quelques mots d’anglais.
Cet événement nous interloqua un peu ; heureusement que le septuor était fini. J’embrassai mes nouveaux amis, et je me disposai à faire route avec eux ; mais ils me dirent qu’ils allaient prendre les chemins de traverse pour se rendre à leur village natal. Je les aurais certainement suivis, si mon voyage n’avait pas eu un but aussi solennel. Enfin, nous nous séparâmes avec une émotion réciproque. Plus tard je me rappelai que personne n’avait ramassé la pièce d’or du voyageur anglais.
Dans la première auberge où j’entrai pour manger un morceau, je trouvai mon gentleman attablé devant un copieux dîner. Il m’examina longtemps avec curiosité, et m’adressant enfin la parole en mauvais allemand, il me demanda ce qu’étaient devenus mes camarades. — Ils sont retournés chez eux, lui dis-je. — Eh bien ! prenez votre violon, me dit-il, et jouez-moi quelque chose ; voici de l’argent. Blessé de cette injonction, je lui répondis que je n’étais pas un artiste mercenaire, et que d’ailleurs je n’avais pas de violon ; et enfin je lui fis le récit de ma rencontre avec ces musiciens. — Des musiciens excellents ! répartit l’Anglais, et dignes de la belle symphonie de Beethoven. Frappé à mon endroit sensible, je demandai à l’Anglais s’il faisait aussi de la musique. — Yes ! me dit-il, je joue de la flûte deux fois par semaine, le jeudi je donne du cor de chasse, et le dimanche je compose. » Voilà, me dis-je, un temps bien employé ! Jamais je n’avais entendu parler d’artiste anglais en tournée, et je jugeai que celui-ci devait faire de bien bonnes affaires pour courir le pays en si brillant équipage. — Vous êtes donc musicien de profession ? lui dis-je. Il me fit longtemps attendre sa réponse ; enfin il me dit, en appuyant lentement sur ses paroles, qu’il avait beaucoup d’argent. Je compris soudain ma méprise, et je vis bien que ma question l’avait choqué. Je dissimulai mon embarras en gardant le silence, et je terminai à l’écart mon modeste repas. L’Anglais, qui m’avait considéré de nouveau avec attention, se rapprocha de moi et me dit : — Connaissez-vous Beethoven ? — Je ne suis pas encore allé à Vienne, répondis-je, mais je m’y rends actuellement, et c’est précisément pour satisfaire mon ardent désir de voir cet illustre maître. — D’où venez-vous ? ajouta-t-il. — De la ville de L… — Oh ! ce n’est pas loin ; moi, je viens d’Angleterre, et c’est aussi dans l’unique but de connaître la personne de Beethoven. Eh bien ! nous le visiterons ensemble. C’est un bien grand compositeur !
Quelle bizarre rencontre ! dis-je en moi-même. Ô mon illustre maître ! quels pèlerins de nature diverse attire ta célébrité ! Riche et pauvre cheminent à la fois sur la même route pour venir contempler tes traits ! — Cet Anglais m’intéressait, mais je ne lui enviais pas son équipage ; il me semblait que j’accomplissais avec mes humbles ressources une action plus digne que la sienne, et que j’en recueillerais une joie plus parfaite et plus pure que celui qu’escortait tant de luxe et d’aisance. Le cornet du postillon retentit, et l’Anglais remonta en voiture en me criant, pour adieu, qu’il verrait Beethoven avant moi.
Après avoir marché quelques heures, je rejoignis le gentleman sur la grande route. Une roue de sa voiture s’était brisée, mais il n’en restait pas moins tranquillement assis à sa place, aussi bien que le domestique sur son siège extérieur. J’appris qu’ils attendaient ainsi le postillon qui était allé quérir un charron à un village assez éloigné. Il était parti depuis longtemps, me dit le maître ; et comme son domestique ne savait parler qu’anglais, je me décidai à aller moi-même presser son retour. Je le trouvai en effet dans un bouchon occupé à boire, et ne s’embarrassant guère de son gentleman. Je le ramenai cependant avec le charron, et, le dommage réparé, l’Anglais repartit en me promettant de m’annoncer chez Beethoven.
Quel fut mon étonnement de rejoindre encore une fois, le jour suivant, le noble voyageur arrêté de nouveau sur la route. Mais cette fois il ne s’agissait plus d’une roue brisée ; il stationnait paisiblement au bout de la chaussée, et parut fort aise de me voir paraître, traînant un peu la jambe. — Oh ! me dit-il, il y a quatre heures que j’attends là exprès pour vous, car je me suis repenti de ne pas vous avoir proposé hier de m’accompagner : il vaut mieux se faire traîner que d’aller à pied ; montez à côté de moi. Surpris de ce procédé, je balançai quelque temps à répondre ; mais je me souvins du vœu que j’avais prononcé à l’auberge d’accomplir en dépit de tous les obstacles mon saint pèlerinage à pied : j’en fis donc à l’Anglais la déclaration formelle, et ce fut son tour de s’étonner. Il me répéta son offre, en ajoutant expressément qu’il avait attendu plusieurs heures ; mais je restai inébranlable, et il partit seul, ne comprenant rien à mon refus. Dans le fond, je me sentais pour cet homme une secrète répugnance, et je ne sais quel pressentiment m’avertissait de me défier de sa funeste influence. Et puis son enthousiasme pour Beethoven et cette curiosité de le connaître me paraissait plutôt être le caprice d’un riche désœuvré que le vif et pur sentiment d’une admiration réfléchie. Je préférai donc de ne pas profaner par une liaison inconsidérée la piété sincère qui me faisait agir.
Mais, hélas ! comme pour préluder aux tristes désappointements que me réservait ma mauvaise étoile, et dont cet Anglais devait être l’instrument, nous nous trouvâmes encore le soir même face à face à la porte d’une autre hôtellerie, où il semblait s’être arrêté à dessein pour m’attendre ; car je le trouvai assis dans sa voiture, tourné du côté de la route par où je devais arriver. — C’est vous que j’attendais depuis longtemps, me dit-il comme la première fois ; voulez-vous que nous allions ensemble voir Beethoven ? Cette fois ma surprise céda en moi à un sentiment de répulsion instinctif. Cette opiniâtreté à m’obliger malgré moi me paraissait inexpliquable, à moins que l’Anglais ne prît à tâche de vaincre ma résistance, parce qu’elle choquait sa susceptibilité, et pour humilier mon amour-propre. Je repoussai donc sa proposition en laissant percer toute l’humeur qu’elle m’inspirait. Alors il s’écria : — Goddam ! vous estimez donc bien peu Beethoven ! Moi je le verrai bientôt. Et il donna le signal du départ.
Ce fut définitivement la dernière fois que je revis ce singulier voyageur avant d’arriver à Vienne. Enfin j’atteignis la barrière de cette capitale ; j’étais au terme de mon pèlerinage. Je vous laisse à juger quelles furent mes émotions en pénétrant dans la Mecque de mes désirs. J’oubliai soudain tous les soucis, toutes les fatigues de la route ; je foulais le même sol où reposait la demeure de Beethoven !… J’étais trop agité pour songer à la réalisation immédiate de mes vœux les plus chers ; je m’informai seulement du quartier qu’habitait le grand compositeur, afin de me loger autant que possible dans son voisinage. Presqu’en face de sa demeure, je trouvai un hôtel de modeste apparence, où je louai une petite chambre au cinquième étage, et là je me préparai à l’événement le plus solennel de ma vie. Je consacrai deux jours au repos, et après avoir jeûné et prié, indifférent à tout le reste, je m’encourageai de mon mieux, et je me dirigeai tout droit vers la maison consacrée par le génie. Mais on me dit que M. Beethoven n’était pas chez lui. Je ne sais pourquoi j’en fus bien aise, je me retirai, et me livrai à un nouveau recueillement. Le lendemain, après avoir essuyé quatre fois la même réponse, toujours plus rudement accentuée, je me persuadai que j’avais choisi un jour malencontreux, et je n’insistai pas davantage.
Comme je rentrais à mon hôtel, quelqu’un qui se trouvait à la croisée du premier étage m’adressa un salut amical : c’était mon voyageur anglais. — Avez-vous vu Beethoven ? me dit-il. — Pas encore, il n’y était pas, lui répondis-je, fort surpris de cette rencontre inattendue. Alors il vint au-devant de moi sur l’escalier, et m’obligea avec une extrême affabilité à entrer chez lui. — Monsieur, me dit-il, je vous ai vu vous présenter cinq fois au logis de Beethoven. Il y a déjà plusieurs jours que je suis ici, et c’est pour être voisin de sa demeure que je me suis logé dans ce vilain hôtel. Je vous assure qu’il est très difficile de l’aborder. Ce gentleman est très lunatique. En arrivant, je me suis présenté chez lui jusqu’à six fois par jour, et j’ai été constamment éconduit. À présent, j’ai pris le parti de me lever de très bonne heure et de me poster à cette fenêtre, où je reste jusqu’au soir pour épier la sortie du maestro. Mais je commence à croire qu’il ne sort jamais de chez lui. — Ainsi, m’écriai-je, vous croyez donc que Beethoven était aujourd’hui chez lui, et qu’il m’a refusé sa porte ? — Positivement ! répliqua-t-il ; nous sommes consignés l’un et l’autre, et cela est fort désagréable pour moi, qui n’ai fait le voyage que pour le voir, et nullement pour la cité de Vienne. Cette confidence m’affligea. Je fis pourtant le lendemain une nouvelle tentative ; mais elle fut aussi vaine que les autres ; l’entrée du paradis m’était décidément interdite. Mon Anglais qui, de son balcon, suivait de l’œil mes allées et venues avec une attention scrupuleuse, avait acquis la certitude, par des informations précises, que Beethoven habitait le corps de logis postérieur de la maison, ce qui le désolait fort, mais il n’en persévérait pas moins opiniâtrement dans son système d’observation. Ma patience, au contraire, fut bientôt à bout, et j’avais pour cela des raisons majeures. Une semaine s’était écoulée déjà en démarches infructueuses, et le produit limité de mes galops ne me permettait pas de prolonger beaucoup mon séjour à Vienne.
Le désespoir commençait à me gagner. Enfin, je confiai mon désappointement au maître de l’hôtel, et celui-ci me promit de m’aplanir tous les obstacles, mais à condition de ne rien révéler à l’Anglais. Tout disposé à me méfier de ce malencontreux personnage, je prêtai volontiers le serment qu’on me demandait. — Voyez-vous, me dit l’honnête hôtelier, il vient ici une kyrielle d’Anglais pour voir M. Beethoven et lier connaissance avec lui, ce qui le contrarie à l’excès, et leur indiscrète curiosité le met tellement hors de lui-même qu’il s’est déterminé à fermer sa porte à tous les étrangers sans exception. C’est un homme un peu original, et il faut l’excuser. Cela fait, du reste, fort bien les affaires de mon hôtel, car j’ai toujours ici bon nombre d’Anglais dans l’expectative, qui, grâce à la difficulté d’aborder M. Beethoven, sont obligés de séjourner ici plus longtemps. Mais puisque vous me promettez de ne donner l’alarme à personne, j’espère vous procurer incessamment la faveur d’être introduit auprès de M. Beethoven.
Ainsi chose plaisante ! c’était parce qu’on me confondait, moi, pauvre diable, avec MM. les touristes anglais que je n’avais pu réussir dans mon pieux dessein. Oh ! mes pressentiments n’étaient que trop vérifiés. Je devais à l’Anglais maudit la plus amère des déceptions. Je me déterminai aussitôt à déménager, car il était clair que tous les hôtes de cette auberge passaient chez Beethoven pour autant d’Anglais, et c’était là le motif de ma cruelle exclusion. Cependant la promesse de l’hôte de me faire obtenir une entrevue de Beethoven m’empêcha de partir. L’Anglais, de son côté, lui que je détestais à présent de toute mon âme, n’avait épargné aucune intrigue, aucun embauchement pour arriver à son but, mais il avait échoué néanmoins contre la rigoureuse consigne. Plusieurs jours se passèrent pourtant encore sans aucun résultat et les revenus de mes galops baissaient sensiblement, quand enfin mon hôte me confia que je ne pouvais manquer de voir de près Beethoven, en me rendant le soir dans une certaine brasserie où il avait l’habitude d’aller, et il me donna en même temps des renseignements détaillés qui devaient m’aider à reconnaître le grand artiste. Je me sentis revivre, et je résolus de ne pas remettre mon bonheur au lendemain. Il était impossible de saisir Beethoven à son passage dans la rue, car il sortait toujours de chez lui par une porte de derrière. Il ne me restait donc que la brasserie ; mais je l’y cherchai ce jour-là inutilement, et il en fut de même durant trois soirées consécutives. Enfin, le quatrième jour, comme je me dirigeais de nouveau vers la brasserie, je remarquai avec désespoir que l’Anglais me suivait de loin avec circonspection. Le malheureux, toujours posté à sa croisée, avait remarqué ma sortie à heure fixe, cela l’avait frappé, et, persuadé que je devais, pour en agir ainsi, avoir découvert le secret qui donnait accès près de Beethoven, il s’était décidé à me suivre, pour profiter de nia découverte. Il me raconta tout avec une naïve franchise, et finit par me déclarer qu’il me suivrait partout. J’eus beau protester que le but de ma promenade était tout simplement une modeste brasserie, beaucoup trop modeste pour mériter la visite d’un gentleman aussi distingué, il fut inébranlable dans sa résolution, et je maudissais ma triste destinée. Je cherchai à la fin à me défaire de lui par l’incivilité de mes procédés, mais il parut n’y attacher aucune importance, et se contentait de sourire doucement. Son idée fixe était de voir Beethoven, et il se souciait peu du reste.
Effectivement, je devais ce jour-là même jouir enfin pour la première fois de la vue de l’illustre compositeur. Rien ne saurait peindre mon ravissement et ma secrète rage tout à la fois, quand, assis côte à côte avec mon gentleman, je vis s’avancer le musicien allemand dont la tournure et les manières répondaient de tout point au signalement que m’avait fourni l’aubergiste. Une taille élevée, que dessinait une longue redingote bleue, des cheveux gris ébouriffés, et les mêmes traits, la même expression de visage que depuis si longtemps évoquait mon imagination. Il était impossible de s’y tromper, et je l’avais reconnu au premier coup d’œil. Il s’avança vivement, quoiqu’à petits pas, de notre côté. Le respect et la surprise enchaînaient tous mes sens. L’Anglais ne perdit pas un seul de mes mouvements, et examinait d’un œil curieux le nouveau venu, qui, après s’être retiré, dans l’endroit le plus écarté du jardin, peu fréquenté, du reste, à cette heure, se fit apporter par le garçon une bouteille de vin, et puis demeura quelque temps dans une attitude pensive, les mains appuyées sur le pommeau de sa canne. Mon cœur palpitant me disait : c’est lui ! Pendant quelques minutes, j’oubliai mon voisin, et je contemplai d’un regard avide, avec une émotion indéfinissable, cet homme de génie qui seul maîtrisait tous mes sentiments et toutes mes idées, depuis que j’avais appris à penser et à sentir. Involontairement je me mis à parler tout bas, et j’entamai une sorte de soliloque qui se termina par ces mots trop significatifs : « Beethoven ! c’est donc toi que je vois ! » Mais rien n’échappa à mon inquisiteur, et je fus subitement réveillé de ma profonde extase par ces paroles confirmatives : — Yes ! ce gentleman est Beethoven lui-même ! venez avec moi et abordons-le tous deux.
Plein d’anxiété et de dépit, je saisis par le bras le maudit Anglais pour le retenir à sa place : « Qu’allez-vous faire ? lui dis-je ; voulez-vous donc nous compromettre, ici, sans plus de cérémonie ?…
— Mais, répliqua-t-il, c’est une excellente occasion, qui ne se retrouvera peut-être jamais. En même temps, il tira de sa poche une espèce d’album, et se dirigea tout droit vers l’homme à la redingote bleue. Exaspéré au dernier point, je saisis de nouveau cet insensé par les basques de son habit, en lui criant avec force : — Avez-vous donc le diable au corps !
Cette altercation éveilla l’attention de l’étranger. Il paraissait deviner avec un sentiment pénible qu’il était l’objet de ce conflit, et s’étant empressé de vider son verre, il se leva pour s’en aller. Mais l’Anglais s’en fut à peine aperçu qu’il fit un violent effort pour s’arracher à ma contrainte, et me laissant un pan de son frac entre les mains, il se précipita sur le passage de Beethoven. Celui-ci chercha à l’éviter, mais le traître ne lui en laissa pas la faculté, il lui adressa un élégant salut selon les règles de la fashion britannique, et l’apostropha en ces termes : — J’ai l’honneur de me présenter au très illustre compositeur et très honorable monsieur Beethoven. — Il fut dispensé d’en dire davantage, car à la première syllabe Beethoven avait fait un écart rapide, et en jetant un regard furtif de mon côté, avait franchi le seuil du jardin avec la rapidité de l’éclair. Cependant l’imperturbable Anglais se disposait à courir après lui ; mais je l’arrêtai d’un mouvement furieux en m’accrochant à sa dernière basque, et lui, se retournant d’un air surpris, dit avec un ton singulier : — Goddam ! ce gentleman est digne d’être Anglais. C’est un bien grand homme, et je ne tarderai pas à faire sa connaissance.
Je demeurai pétrifié ; cette affreuse aventure m’ôtait désormais tout espoir de voir s’accomplir le plus ardent de mes vœux.
Je restai convaincu dès lors que toutes mes démarches pour avoir accès auprès de Beethoven seraient désormais infructueuses ; et, d’après la position de mes finances, je n’avais plus d’autre parti à prendre que de retourner sur mes pas, ou bien de risquer encore, pour parvenir à mon but, quelque tentative désespérée. La première alternative me faisait frissonner ; et qui ne se serait pas révolté à l’idée de se voir à jamais exclu du port après en avoir déjà franchi le seuil ? Avant de subir une aussi cruelle déception, je résolus donc de tenter un suprême effort. Mais à quel procédé avoir recours ? Quel chemin pouvait m’offrir l’issue favorable ? Je fus longtemps sans rien imaginer d’ingénieux. Toutes mes facultés, hélas ! étaient frappées d’atonie, et mon esprit était uniquement préoccupé de ce que j’avais vu tandis que j’étais accroché aux basques du maudit Anglais. Le regard furtif que m’avait lancé Beethoven dans cette affreuse conjoncture n’était que trop significatif : il m’avait assimilé à un Anglais ! Comment détruire cette funeste prévention dans l’esprit du grand compositeur ? Comment lui faire savoir que j’étais un franc et naïf Allemand, aussi pauvre d’argent que riche d’enthousiasme ? — Enfin, je me décidai à soulager mon cœur oppressé en lui écrivant. Je traçai donc sur le papier une brève histoire de ma vie ; je lui racontais de quelle manière j’étais devenu musicien, quelle adoration je professais pour son génie, et quelle était ma tentation de le connaître et de le voir de près. Je ne lui cachais pas que j’avais sacrifié, pour y parvenir, deux années entières à me créer une réputation dans la facture des galops et des pots-pourris ; enfin, je lui décrivais les détails de mon pèlerinage et quelles souffrances m’avaient causées la rencontre et l’obstination de l’horrible touriste anglais.
Tout en rédigeant ce récit de mes infortunes, mon cœur se dilatait, et j’arrivai, en finissant ma lettre, à une sorte d’épanchement confidentiel qui m’inspira même quelques reproches nettement articulés sur sa cruauté à mon égard et l’injustice de ses soupçons. Ma péroraison était pleine de feu, et j’eus pour ainsi dire un éblouissement en relisant l’adresse que je venais d’écrire : À Monsieur Louis de Beethoven. J’adressai au Ciel une muette prière, et j’allai moi-même remettre ma lettre au concierge.
Mais en rentrant à mon hôtel, ivre d’espérance, quel fut mon désappointement en apercevant encore l’Anglais à sa fenêtre ! Il m’avait vu sortir de la maison de Beethoven ; il avait remarqué l’expression joyeuse et fière de ma physionomie, et il n’en fallait pas davantage pour réveiller les importunités de sa malveillance tyrannique. Il vint à ma rencontre sur l’escalier en me disant : — Eh bien ! bon espoir ! Quand reverrons-nous Beethoven ? — Jamais, jamais ! lui dis-je ; Beetheven ne sera plus visible pour vous. Laissez-moi, monsieur ! il n’y a rien de commun entre nous ! — Oh ! pardonnez-moi, répondit-il ; et la basque de mon habit ? De quel droit, monsieur, avez-vous agi ainsi avec moi ? C’est vous qui êtes cause de la réception que m’a faite M. Beethoven. Il est clair qu’il a dû se formaliser de cette inconvenance.
Outré d’une aussi ridicule prétention, je m’écriai : — Monsieur, je vous rendrai la basque de votre frac. Vous pourrez le conserver comme un souvenir honteux de votre offense envers l’illustre Beethoven, et de vos persécutions inouïes envers un pauvre musicien. Adieu, monsieur, et puissions-nous ne jamais nous revoir ! Il chercha à me retenir, en me disant, pour me tranquilliser, qu’il avait encore bon nombre d’habits en parfait état, et me demandant par grâce de lui apprendre quel jour Beethoven consentirait à nous recevoir. Mais je m’élançai avec impétuosité jusqu’à ma mansarde, et je m’y enfermai pour attendre impatiemment la réponse à ma lettre.
Comment exprimer ce qui se passa en moi lors qu’au bout d’une heure à peu près, on m’apporta un petit fragment de papier à musique sur lequel étaient tracées à la hâte les lignes suivantes :
« Pardonnez-moi, monsieur R…, de ne pouvoir vous recevoir que demain avant midi, étant occupé aujourd’hui à préparer un paquet de musique, qui doit partir par le courrier. Demain je vous attendrai.
« Beethoven. ».
Je tombai involontairement à genoux, les yeux baignés de larmes délicieuses, et je rendis grâce à Dieu de cette insigne faveur. Mon ravissement se traduisit ensuite par des bonds sauvages, et je me livrai dans ma petite chambre aux contorsions les plus folles. J’ignore quelle figure de danse j’exécutai dans mon délire ; mais je me rappelle encore avec quelle confusion je m’interrompis subitement en entendant quelqu’un qui semblait m’accompagner en sifflant l’air d’un de mes galops. Rendu à mon sang-froid par cette allusion ironique, je pris mon chapeau, je sortis de l’hôtel, et je m’élançai à travers les rues de Vienne, léger et fringant comme un écolier en maraude. Mes tribulations, hélas ! m’avaient jusque-là fait oublier que j’habitais Vienne. Aussi combien ne fus-je pas alors émerveillé du brillant aspect de cette ville impériale ! Dans mon état d’exaltation, tout s’offrait à moi sous les plus séduisantes couleurs. La sensualité superficielle des habitants me paraissait une ardeur vitale pleine de fécondité, et dans leur manie de jouissances futiles et éphémères, je ne voyais qu’une active passion de l’art et du beau. Je lus les cinq affiches journalières des spectacles, dont l’une portait en gros caractères l’annonce de Fidelio, musique de Beethoven.
Comment me dispenser d’une semblable fête, malgré la piteuse situation de ma bourse ? On commençait l’ouverture au moment même où j’entrais au parterre. Je reconnus aussitôt que c’était un remaniement de l’opéra donné d’abord sous le titre de Léonore, et qui, à l’honneur du public viennois, n’avait obtenu à sa première apparition aucun succès. On ne peut nier, à la vérité, que l’ouvrage n’ait beaucoup gagné à son remaniement ; mais cela vient surtout de ce que l’auteur du second libretto offrit au musicien plus d’occasions de développer son brillant génie ; Fidelio possède d’ailleurs en propre ses admirables finales et plusieurs autres morceaux d’élite. Je ne connaissais, du reste, que l’opéra primitif. Qu’on juge donc de mon ravissement à l’audition de ce nouveau chef-d’œuvre ! Une très jeune fille était chargée du rôle de Léonore ; mais cette actrice paraissait tellement s’être identifiée, dès son âge le plus tendre, avec le génie de Beethoven, qu’elle remplissait sa tâche avec une énergie poétique faite pour émouvoir l’âme la plus insensible ; elle s’appelait Schrœder. Qui ne connaît aujourd’hui la réputation européenne de la cantatrice qui porte maintenant le double nom de Schrœder-Devrient ? À elle appartient la gloire d’avoir révélé au public allemand le sublime mérite de Fïdelio, et je vis ce soir-là le parterre étourdi de Vienne fasciné et fanatisé par son merveilleux talent. Pour ma part, j’étais ravi au troisième ciel.
Je ne pus fermer l’œil de la nuit. C’en était trop de ce que je venais d’entendre et du bonheur que me réservait le lendemain, pour que mes sens se laissassent captiver par l’illusion décevante d’un rêve. Je demeurai donc éveillé, livré à une ardente extase et tâchant de préparer dignement mes idées à l’entrevue solennelle qui m’était promise. Enfin le jour parut. J’attendis avec anxiété l’heure la plus convenable pour me présenter, et quand elle sonna, je tressaillis jusqu’à la moelle des os, enivré du bonheur dont j’allais jouir après tant de traverses et de mécomptes.
Mais une horrible épreuve m’attendait encore. Je trouvai froidement accoudé contre la porte de la maison de Beethoven un homme, un démon, cet Anglais acharné. Le diabolique personnage avait semé l’or de la corruption, et l’aubergiste vendu tout le premier à mon implacable ennemi, l’aubergiste qui avait lu le billet non cacheté de Beethoven, avait tout révélé au gentleman. Une sueur froide m’inonda à sa vue. Tout mon enthousiasme, toute la poésie de mes rêves furent glacés, anéantis ; je retombai sous la griffe maudite de mon mauvais ange.
— Venez ! me dit-il dès qu’il m’aperçut, allons ! entrons chez Beethoven. Je voulus d’abord le dérouter en niant que tel fût l’objet de ma démarche ; mais il m’en ôta bientôt la faculté en m’avouant par quel moyen il avait surpris mon secret, et il affirma qu’il ne me quitterait pas avant d’avoir vu Beethoven avec moi. J’essayai d’abord de lui démontrer combien son projet était déraisonnable : vaines paroles ! Je me mis en colère et m’efforçai de le quereller : vains efforts ! À la fin, j’espérai pouvoir me soustraire à cette contrainte par la vivacité de mes jambes ; je montai l’escalier quatre à quatre, et tirai violemment le cordon de la sonnette. Mais avant qu’on eût ouvert la porte, l’Anglais m’avait atteint, et se cramponnant par derrière à mon habit : — J’ai, me dit-il, un droit sur vos basques, et je ne lâcherai prise, mon cher, que devant Beethoven lui-même ! Poussé à bout, je me retourne avec fureur, presque résolu à me servir des voies de fait pour me débarrasser de l’orgueilleux insulaire, quand la porte s’ouvre, et une vieille gouvernante, d’une mine assez revêche, à l’aspect de cet étrange conflit, s’apprêtait déjà à la refermer. Dans une angoisse extrême, je criai mon nom avec éclat en protestant que Beethoven lui-même m’avait donné rendez-vous à cette heure. Mais la vieille ne paraissait pas parfaitement convaincue, tant la vue du gentleman lui inspirait une juste méfiance, lorsque Beethoven parut lui-même sur la porte de son cabinet. Je m’avançai aussitôt pour lui présenter mes excuses, mais j’entraînai à ma suite l’Anglais damné qui ne m’avait pas lâché, et qui en effet ne me laissa libre que lorsque nous fûmes précisément en face de Beethoven. Je dis à celui-ci mon nom qu’il ne pouvait comprendre étant complètement sourd, mais pourtant il parut deviner que c’était moi qui lui avais écrit la veille. Alors il me dit d’entrer ; et aussitôt, sans se laisser troubler le moins du monde par la contenance pleine de surprise de Beethoven, l’Anglais se glissa sur mes pas dans le cabinet.
J’étais donc enfin dans le sanctuaire ; mais la gêne affreuse où me jetait l’incroyable procédé de mon compagnon m’ôtait toute la sérénité d’esprit qui m’eût été nécessaire pour apprécier toute l’étendue de mon bonheur. Beethoven n’avait dans son extérieur, il faut en convenir, rien de séduisant. Vêtu d’un négligé fort en désordre, il avait le corps ceint d’une écharpe de laine rouge. Son abondante chevelure grise encadrait son visage, et l’expression de ses traits, sombre et même dure, n’était guère capable de mettre un terme à mon embarras. Nous nous assîmes devant une table couverte de papiers ; mais une préoccupation pénible nous dominait tous, personne ne parlait, et Beethoven était visiblement contrarié de donner audience à deux personnes au lieu d’une. Enfin il me dit d’un ton brusque : — Vous venez de L… ? J’allais lui répondre, mais il m’arrêta en me présentant une main de papier avec un crayon, et il ajouta : — Ecrivez, s’il vous plaît. Je n’entends pas.
J’étais instruit de la surdité de Beethoven, et pourtant ce fut comme un coup de poignard que ces mots articulés de sa voix rauque : Je n’entends pas ! Vivre dans la pauvreté et les privations, n’avoir au monde d’autre consolation, d’autre joie que la pensée de sa puissance comme musicien, et se dire, à toute heure, à toute minute : Je n’entends pas !… Je lus dans ce seul mot tout le secret de l’aspect défavorable de Beethoven ; je compris la raison de cette tristesse profonde empreinte dans sa physionomie, de la sombre humeur de son regard, et du dépit concentré d’ordinaire sur ses lèvres : il n’entendait pas !… Plein de trouble et d’émotion, et à peine maître de moi, j’écrivis pourtant quelques mots d’excuse accompagnés d’une brève explication des circonstances qui avaient amené chez lui l’Anglais à mes trousses. Celui-ci était demeuré immobile, en silence, et très satisfait de lui-même, en face de Beethoven qui, après avoir lu mes lignes manuscrites, lui demanda assez brusquement ce qu’il y avait pour son service.
— J’ai l’honneur, répliqua l’Anglais… — Monsieur, dit Beethoven, je ne vous entends pas, et je ne puis pas beaucoup parler non plus. Écrivez ce que vous désirez de moi. L’Anglais réfléchit un moment, puis il tira de sa poche un élégant album de musique, en me disant : Très bien ! voulez-vous écrire que je prie M. Beethoven d’examiner mes compositions, et s’il y trouve quelque passage qu’il n’approuve pas, de vouloir bien les signaler par une croix.
J’écrivis sa réclamation mot à mot dans l’espoir d’être bientôt débarrassé de sa présence ; et j’avais deviné juste. Beethoven, après avoir lu, écarta de la main sur la table, avec un étrange sourire, l’album de l’Anglais, et lui dit enfin : Je vous le renverrai, monsieur. Mon gentleman enchanté se leva, fit une superbe révérence, et se retira.
Je respirai enfin ! La physionomie de Beethoven lui-même perdit quelque chose de son austérité, il me considéra quelques secondes, et me dit : « Cet Anglais paraît vous avoir beaucoup tourmenté ; consolez-vous-en avec moi, car il y a longtemps que je suis en butte à ces odieuses persécutions. Ils viennent visiter un pauvre musicien comme ils iraient voir une bête curieuse. Je suis peiné de vous avoir un moment confondu avec cette sorte de gens. Votre lettre témoigne que mes compositions vous ont satisfait ; cela me fait plaisir, car j’ai renoncé à peu près à conquérir les suffrages de la multitude ». Ces paroles simples et familières dissipèrent toute ma timidité, et, pénétré de joie, j’écrivis que j’étais loin assurément d’être le seul qui brûlât du même enthousiasme pour les productions de son brillant génie, et que le plus ardent de mes vœux serait de le voir un jour dans l’enceinte de ma ville natale, où il jouirait de l’admiration unanime inspirée par son talent.
— Les Viennois, en effet, me dit-il, m’impatientent souvent, ils entendent journellement trop de futilités déplorables pour pouvoir écouter de la musique sérieuse avec la gravité convenable.
Je voulus réfuter cette critique en citant les transports dont j’avais été témoin la veille à la représentation de Fidelio. — Hum, hum ! fit-il, Fidelio ?… Mon Dieu, c’est par vanité personnelle qu’ils applaudissent cet ouvrage de la sorte, à cause de la docilité pour leurs conseils dont ils s’imaginent que j’ai fait preuve dans le remaniement de cette partition, et ils croient que leur approbation de commande est une parfaite compensation de mon pénible travail. Ce sont de braves gens, mais légers de science ; et c’est pour cela, du reste, que leur société me plaît davantage que la vôtre, messieurs les érudits. Du reste, comment trouvez-vous Fidelio maintenant ?
— Je lui fis part de l’impression délicieuse que j’avais ressentie la veille, en observant que l’adjonction des nouveaux morceaux avait merveilleusement modifié et complété tout l’ensemble. — Maudite besogne ! répartit Beethoven. L’opéra n’est point mon fait ; du moins je ne connais pas de théâtre au monde pour lequel je voudrais m’engager à composer un nouvel ouvrage. Si j’écrivais une partition conformément à mes propres instincts, personne ne voudrait l’entendre, car je n’y mettrais ni ariettes, ni duos, ni rien de tout ce bagage convenu qui sert aujourd’hui à fabriquer un opéra, et ce que je mettrais à la place ne révolterait pas moins les chanteurs que le public. Ils ne connaissent tous que le mensonge et le vide musical déguisés sous de brillants dehors, le néant paré d’oripeaux. Celui qui ferait un drame lyrique vraiment digne de ce nom passerait pour un fou, et le serait en effet, s’il exposait son œuvre à la critique du public, au lieu de la garder pour lui seul.
— Et comment lui demandai-je, faudrait-il s’y prendre pour composer un semblable opéra ? — Comme Shakespeare dans ses drames, répondit-il ; et il ajouta : Quand on consent à adapter au timbre de voix d’une actrice de ces misérables colifichets musicaux destinés à lui procurer les bravos frénétiques d’un parterre frivole, on est digne d’être rangé dans la classe des coiffeurs ou des fabricants de corsets, mais il ne faut pas aspirer au titre de compositeur. Quant à moi, de semblables humiliations me répugnent. Je n’ignore pas que bien des gens raisonnables, tout en me reconnaissant un certain mérite en fait de composition instrumentale, se montrent beaucoup plus sévères à mon égard au sujet de la musique vocale. Ils ont raison, si par musique vocale ils entendent la musique d’opéra, et Dieu me préserve à jamais de me complaire à des niaiseries de ce genre.
Je me permis de lui demander si jamais quelqu’un avait osé, après avoir entendu sa cantate d’Adélaïde, lui refuser la vocation la plus caractérisée pour le genre de la musique vocale. — Eh bien ! me répondit-il après une courte pause, Adélaïde et quelques autres morceaux de la même nature ne sont que des misères qui tombent assez tôt dans le domaine de la vulgarité, pour fournir aux virtuoses de profession un thème de plus qui puisse servir de cadre à leurs tours de force gutturaux. Mais pourquoi la musique vocale n’offrirait-elle pas, aussi bien que le genre rival, matière à une école sévère et grandiose ? La voix humaine est pourtant un instrument plus noble et plus beau que tout autre ; pourquoi ne pourrait-on pas lui créer un rôle aussi indépendant ? Et à quels résultats inconnus ne conduirait pas un pareil système ? Car la nature si multiple des voix humaines, et en même temps si différente de celle de nos instruments, donnerait à cette nouvelle musique un caractère tout spécial en lui permettant les combinaisons les plus variées. Les sons des instruments, sans qu’il soit possible pourtant de préciser leur vraie signification, préexistaient en effet dans le monde primitif comme organes de la nature créée, et avant même qu’il y eût des hommes sur terre pour recueillir ces vagues harmonies. Mais il en est tout autrement du génie de la voix humaine ; celle-ci est l’interprète directe du cœur humain, et traduit nos sensations abstraites et individuelles. Son domaine est donc essentiellement limité, mais ses manifestations sont toujours claires et précises. Eh bien ! réunissez ces deux éléments ; traduisez les sentiments vagues et abrupts de la nature sauvage par le langage des instruments, en opposition avec les idées positives de l’âme représentées par la voix humaine, et celle-ci exercera une influence lumineuse sur le conflit des premiers, en réglant leur élan et modérant leur violence. Alors le cœur humain s’ouvrant à ces émotions complexes, agrandi et dilaté par ces pressentiments infinis et délicieux, accueillera avec ivresse, avec conviction, cette espèce de révélation intime d’un monde surnaturel.
Ici Beethoven essoufflé s’arrêta un moment, puis il reprit en soupirant : — Il est vrai qu’une pareille tâche présente mille obstacles dans la pratique ; car pour faire chanter il faut des paroles, et qui serait capable de formuler en paroles la poésie sublime qui serait le brillant résultat de la fusion de tous ces éléments ? L’art de l’écrivain serait évidemment impuissant pour y parvenir. Je publierai bientôt un nouvel ouvrage qui vous rappellera les idées que je viens d’émettre : c’est une symphonie avec chœurs ; mais je dois appuyer sur les difficultés que m’a suscitées en cette circonstance l’insuffisance du langage poétique. Enfin j’ai arrêté mon choix sur la belle hymne de Schiller : À la joie. Ce sont là assurément de nobles et beaux vers, et pourtant qu’ils sont loin d’exprimer tout ce que j’ai rêvé à ce sujet
À présent même, j’ai peine à maîtriser l’émotion de mon cœur en me rappelant ces confidences par lesquelles le grand artiste m’initiait dès lors à l’intelligence complète de sa dernière et prodigieuse symphonie, qu’il venait à peine de terminer. Je lui exprimai ma reconnaissance avec toute l’effusion que devait provoquer cette insigne faveur, et je lui témoignai combien j’étais transporté d’apprendre la prochaine apparition d’un nouvel ouvrage de son génie. Je sentais mes yeux mouillés de larmes, et je fus presque tenté de m’agenouiller devant lui. Beethoven parut comprendre ce qui se passait en moi, il fixa sur moi un regard mélangé de tristesse et d’ironie, et me dit : — Vous pourrez prendre ma défense lorsqu’il s’agira de mon nouvel ouvrage. Rappelez- vous alors cet entretien, car je serai sans doute accusé de folie et de déraison par mainte personne raisonnable. Vous voyez pourtant bien, mon cher monsieur R…, que je ne suis pas encore précisément atteint de démence, quoique j’aie subi assez de tribulations depuis longtemps pour en courir la chance. Le monde voudrait que je prisse pour règle les idées qu’il se forme du beau, et non les miennes ; mais il ne songe pas que dans mon triste état de surdité, je ne puis obéir qu’à mes inspirations intimes, qu’il me serait impossible de mettre dans ma musique autre chose que mes propres sentiments, et que le cercle restreint de ma pensée n’embrasse pas, comme lui, leurs mille perceptions enivrantes, qui me sont totalement inconnues, ajouta-t-il avec ironie, et voilà mon malheur !
À ces mots, il se leva et se mit à marcher d’un pas rapide dans la chambre. Dans l’excès de mon émotion, je me levai pareillement, et je me sentis frissonner : il m’eût été impossible de pousser plus loin cet entretien en n’ayant recours qu’à des gestes ou à l’écriture. Il me sembla qu’en demeurant davantage je me rendrais importun ; mais je dédaignai de tracer froidement sur le papier quelques mots de remercîment et d’adieu ; je me bornai à prendre mon chapeau et à m’approcher du maître en lui laissant lire mon respectueux attendrissement dans mes regards. Il parut me comprendre et me dit : — Vous partez ? Restez-vous encore quelque temps à Vienne ? J’écrivis alors que l’unique but de mon voyage avait été de faire sa connaissance, et que, puisqu’il avait daigné m’accueillir avec autant de bonté, il ne me restait qu’à partir pénétré de joie et de reconnaissance. Il me répondit en souriant : — Vous m’avez écrit par quel moyen vous vous étiez procuré l’argent nécessaire à votre voyage. Vous pourriez rester à Vienne pour y publier de nouveaux galops ; c’est une denrée qui se débite ici à merveille. Je déclarai à Beethoven que j’avais renoncé pour jamais à ce genre de travail, et que je ne pouvais concevoir quel motif assez puissant pourrait me déterminer désormais à un pareil acte d’abnégation. — Bah ! bah ! répliqua-t-il, pourquoi donc pas ? Et moi, vieux fou que je suis, ne serais-je pas mille fois plus heureux de composer des galops ; au lieu qu’il me faudra végéter à tout jamais dans la carrière que j’ai embrassée. Bon voyage ! ajouta-t-il, pensez quelquefois à moi, et tâchons d’oublier les déceptions et les traverses de la vie.
Ému jusqu’aux larmes, j’allais me retirer ; mais il me retint encore en me disant : — Arrêtez ! nous allons expédier l’affaire de l’Anglais mélomane. Voyons où il faut mettre des croix ? Il prit en même temps l’album de l’Anglais et le parcourut en souriant, puis il le referma, et l’enveloppant d’une feuille de papier, il fit avec sa plume une énorme croix sur cette blanche enveloppe, en me disant : — Tenez ! remettez, je vous prie, à cet heureux mortel son chef-d’œuvre, et félicitez-le de ma part d’avoir deux oreilles bonnes et valides. J’envie réellement son sort. Adieu, mon cher, et conservez-moi votre amitié.
Ce fut ainsi qu’il me congédia, et je sortis de la maison dans un trouble extrême.
En rentrant à l’hôtel, je trouvai le domestique de l’Anglais occupé à attacher sa valise sur la voiture. Ainsi cet homme avait aussi bien que moi atteint son but, et je fus obligé de convenir qu’il avait fait preuve, à sa manière, de persévérance. Je montai à ma mansarde et fis mes préparatifs de départ pour le lendemain matin. Mes yeux tombèrent sur la grande croix apposée sur l’album de l’Anglais, et je ne pus réprimer un grand éclat de rire. Pourtant cette croix était un souvenir de Beethoven, et je me gardai bien de m’en dessaisir pour le gentleman musicien qui avait été le mauvais génie de mon saint pèlerinage. J’ôtai donc cette enveloppe que je réservai pour la collection de mes galops dignes de ce stigmate réprobateur. Quant à l’Anglais, je lui renvoyai son album intact avec un petit billet où je lui marquais que Beethoven avait été enchanté de sa musique, au point qu’il n’avait pas su où poser une seule croix de blâme.
Comme je quittais l’hôtel, l’Anglais montait justement dans sa voiture : — Oh ! adieu, me criait-il ; vous m’avez rendu un très grand service, et je suis entièrement content d’avoir vu de près Beethoven. Voulez-vous que je vous emmène en Italie ?
— Qui donc allez-vous voir ? lui dis-je.
— Je veux faire la connaissance de M. Rossini. Oh ! c’est un bien grand compositeur.
— Merci, lui répondis-je, je connais Beethoven, et cela me suffit pour ma vie entière.
Nous nous séparâmes. Je jetai un dernier coup d’œil d’attendrissement sur la maison de Beethoven, et je me dirigeai du côté du nord, ennobli et relevé à mes propres yeux.