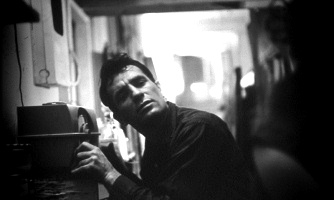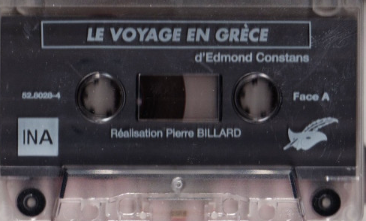La mendigote (13-04-1954) (second lien ici)
de Yvan Noé
avec Jean-Marie Amato (le commissaire), Guy Pierauld (Chapiro), Fernand Rauzéna, Maryse Paillet, Nelly Delmas, Assia, André Var, Jean-Pierre Lituac, Jean Bolo, André Wasley, Raymond Pélissier, Armand Vallé Valdy, Pierre Montcorbier (Justin)
bruitages Gabriel de Rivage
assistant de production Jean Garretto
A Nice, une mendiante est retrouvée morte dans son lit, habillée en robe du soir, avec un gros magot sous son matelas. L’enquête mène vers son fils, petit escroc en train de moisir en prison soudainement héritier, puis vers un mendiant en rivalité avec la défunte (Justin, alias Barbapoux), pour se terminer dans un casino.
L’interprétation, avec en tête le toujours parfait Jean-Marie Amato, s’en donne à cœur joie. La petite troupe de « Faits divers » est bien rodée. On retrouve aussi Fernand Rauzéna, qui fut complice de Pierre Dac dans les années 30.
Pierre Billard table sur ses acteurs pour planter l’atmosphère, plus que sur les bruitages, qui sont minimalistes. Quand il y a des scènes en extérieur, aucun son d’ambiance. Au moment de la découverte du cadavre au début, le commissaire a beau constater dans la pièce une grande quantité de mouches, nous ne les entendons pas, peut-être aussi pour atténuer quelque peu ce détail sordide.
Comme pour les deux émissions suivantes, la fiction est suivie de lectures de faits divers par Maurice Renault et Jean Toscane que complète celui choisi pour inspirer une fiction future, de la rubrique du petit courrier du mystère et de l’aventure (Germaine Beaumont et Roger Régent), et enfin de quelques brèves signées Maurice Renault.
Pierre Véry, parfois aidé de Jean Toscane, boucle le tout en présentant le fait divers qui donnera lieu à la fiction de la semaine suivante.
Pour ce numéro,
Les faits divers : une histoire d’hibernation, avec jeu de mots bien préparé par Maurice Renault pour la chute, et une anglaise à la vue surpuissante.
Germaine Beaumont présente le dernier policier humoristique de Franck Gruber, « Un joli coco ». La série de romans mettant en scène les deux héros, Sam Cragg et Johnny Fletcher a eu quelques succès aux États-Unis dans les années 40/50. Il existe une adaptation au cinéma (« The French Key » une série B du studio Republic, réalisée par un certain Walter Colmes), ainsi que une série radio (en 1948 sur la ABC).
Germaine Beaumont est moins sensible à l’humour de « Avec du tapioca » de Henri David.
La chronique de Roger Régent est exceptionnelle. Roger est enthousiaste, il ne va rien dire de négatif, rien. L’heureux élu est « Tant qu’il y aura des hommes » de Fred Zinnemann. Rien à voir avec le thème de l’émission, ce n’est ni un film d’aventure, ni un policier, mais Roger cette semaine, s’en contrefout. Ce qui l’a marqué, c’est que le film a remporté des Oscar, et qu’il est subversif. Il n’est pas à l’honneur de l’Armée américaine. Roger est touché par « cette atmosphère de désespérance et de grande aventure », ce dernier mot pour, in extremis, être dans les clous.
Roger est un petit cachottier, car il passe sous silence la fameuse scène d’amour torride, quoique balnéaire, entre Deborah Kerr et Burt Lancaster.
Un bon tuyau pour un appartement (20-04-1954) (second lien ici)
de François Timmory
avec Jacqueline Rivière (Minouche Quidam), Jean-Claude Michel (Jean Quidam), Jane Marken (Augustine Toton), Jeanne Dorival (Maryse Moisi), Becky Rosanes (Madame Plumet), Gaëtan Jot (Monsieur Plumet)
bruitages Gabriel de Rivage
assistant de production Jean Garretto
Le fait divers qui sert de point de départ à l’auteur, mais de point d’arrivée dans le récit, est une escroquerie : faire croire à des habitants d’un appartement qu’il est habité par un fantôme pour pouvoir récupérer le logement.
Un jeune couple va essayer de récupérer de cette manière l’appartement d’une de leur voisine. Dès le début, chaque élément mis en place par l’auteur, même celui qui paraît au départ le plus insignifiant, voire le plus invraisemblable (le journal intime du mari décédé retrouvé par le jeune homme dans l’appartement de la veuve) va servir ensuite le récit. Cet artifice efficace, mais classique, permet à la fiction de gagner en rythme.
L’interprétation est dominée par Jane Marken (la veuve) et Jeanne Dorival (l’occultiste). Le dialogue de cette dernière avec le fantôme est savoureux.
Les faits divers : encore une fois, la Grande Bretagne apparaît comme grande pourvoyeuse de faits divers pour l’émission. Ici un oiseau déclenche un dispositif anti-vol, parce qu’il y a élu domicile. Inimaginable en France.
Deux autres faits matrimoniaux, avec un commerçant qui propose l’enregistrement des vœux nuptiaux aux mariés pour qu’ils se les repassent dans les coups durs (ça compte comme fait divers, ça ?), et un photographe qui à cause d’une erreur de manipulation s’est retrouvé avec la photo de la mariée toute nue. Qui de mieux que Jean Toscane pour lire une histoire aussi excitante ?
Autre histoire, choisie pour une fiction à venir, celle d’une télévision où l’image fixe d’une jeune femme reste incrustée, quel que soit le programme.
Pourquoi ne pas avoir choisi l’histoire du photographe ?
Germaine a lu « Crime impuni », le dernier Simenon. « Les romans de Georges Simenon sont toujours attendus avec impatience » nous dit-elle en ouverture. Vu le rythme de parution de ses romans, l’impatience ne durait guère longtemps.
Elle trouve que le roman aurait dû être encore plus court, car la seconde partie ressemble à du tirage à la ligne. Elle se contente de parler du « meilleur du livre, soit de l’atmosphère de cette pension de famille » (la première partie donc), en en résumant copieusement l’intrigue, s’arrêtant juste avant le meurtre, juste après l’avoir fortement suggéré.
Roger a vu deux films. Un « de bonne série » intitulé « Le vol du secret de l’atome », de Jerry Hopper. Histoire de kidnapping en échange de secrets atomiques. On y voit le FBI en action, et plein de suspense. Roger semble satisfait.
L’autre film n’a rien à voir avec l’émission, mais une fois de plus, Roger s’en tamponne. Il a adoré « Vacances romaines » de William Wyler, un film sans policier, ni aventure, ni meurtre, ni vol, pas même une petite escroquerie de rien du tout, mais qu’à cela ne tienne, en conclusion il trouvera une pirouette tirée par les cheveux pour retomber sur ses pattes.
Il nous le dit d’avance, ces vacances romaines, il n’a pas trop le temps d’en parler. Mais il ne faut jamais se fier à son annonce puisque le temps, il va le prendre. Alors il n’a pas grand-chose à en dire : les bons films il les reconnaît à ce qu’on a rien à dire sur eux. Une leçon que tout critique ou historien du cinéma devrait retenir.
Une autre encore « A tous ceux qui voudraient se distraire, se détendre sans complication , sans philosophie, sans littérature, sans message social à la clé, je ne saurais trop le conseiller ».
Les échos de Maurice Renault : la police américaine décide d’humilier les détectives de l’agence Pinkerton, en leur proposant de partir à la recherche des neuf pistolets que l’agence a laissé s’envoler dans la nature.
Une jeune fille blonde en robe de bal (11-05-1954) (second lien ici)
de Jean Marcillac
avec Germaine Kerjean (Mme Le Hallec), Julien Bertheau (Olivier), Jacqueline Rivière (Pascaline), Roger Coggio (Michel), Albert Gercourt, Raymond Pélissier, Jean Bolo, Yves Duchateau, Armand Vallé Valdy, Marcel Lestan, Marie-France
prise de son Noël Barbet
opérateur Charles Marié
bruitages Gabriel de Rivage
assistant de production Jean Garretto
A l’ouverture d’un caveau de famille, on trouve un cercueil supplémentaire. Le fait divers qui sert de point de départ, Jean Marcillac s’en débarrasse dès les premières minutes. Il va axer sa fiction autour d’une histoire d’amour (Pierre Billard a sorti le prélude de « Tristan et Iseult » de Wagner) contrariée par une parente acariâtre, grande industrielle qui ne souhaite pas que son petit-fils se marie avec une fille sans fortune. L’intrigue amoureuse va mal se dénouer pendant l’Occupation allemande.
La fiction est entièrement construite autour d’un seul dialogue, ponctué de retours en arrière, entre le meilleur ami du petit-fils qui va expliquer la présence du corps de cette jeune fille en robe de bal dans le caveau, et la grand-mère teigneuse. L’interprétation de Germaine Kerjean et de Julien Bertheau est parfaite.
La chute de l’histoire, incohérente, mais heureuse, est là pour rassurer les auditeurs, effaçant un peu les atrocités commises par Mme Le Hallec, personnage sorti tout droit de l’univers de Dickens. On pense effectivement à Dickens dans l’opposition simpliste qui est faite entre la pureté, l’innocence du couple d’amoureux et la méchanceté, l’inhumanité de la grande industrielle.
Les faits divers : une jeune fille qui s’amuse à se coucher sur les rails suite à un pari (le train a freiné à temps), et un mort qui offre un banquet à ses héritiers, à Détroit (« Détroïte », dixit Jean Toscane).
Une auditrice invite les auteurs de « Faits divers » à écrire une histoire à base d’empoisonnement. Devant le manque d’originalité de la proposition, les producteurs de l’émission s’enthousiasment, ayant oublié que l’histoire qu’ils viennent de diffuser en contenait déjà un.
Les livres de Germaine : le nouveau roman de Jacques Decrest « Le salon des oiseaux », une nouvelle enquête du commissaire Gilles, est à l’honneur. Jacques Decrest sera plusieurs fois adapté dans les « Maîtres du mystère » entre 1957 et 1962. Autre livre qui a emballé Germaine, « Celui qui murmure » de John Dickson Carr, amateur comme tout un chacun de choses simples comme le surnaturel, les meurtres en chambres closes (souvenir d’une chambre jaune ?) ou la perforation d’industriel en haut d’une tour par une canne épée.
Les quatre films de Roger :
Mon premier est un chef d’œuvre (uniquement dans sa première demi-heure) qui se nomme « Soledad », un film mexicain « robuste ». C’est « l’histoire d’un médecin dans la campagne mexicaine ».
Aucune référence ne nous est donnée. Il existe bien un film mexicain du nom de « Soledad », datant de 1947, et réalisé par Miguel Zacaría. Le synopsis ne porte pas trace d’un médecin en campagne, mais tous les symptômes du mélodrame le plus romanfeuilletonesque qui soit.
Mon second vient d’Angleterre et se nomme les « Kidnapères » (in english « The Kidnappers ») directed by Philip Leacock. Deux enfants kidnappent un bébé. Roger ne voit aucun défaut, tout va bien. Mais… « tout cela ne dépasse pas une agréable gentillesse ». Aïe aïe aïe…
Mon troisième est « Une femme qui s’affiche » de George Cukor. Roger est aux anges. Effectivement c’est un peu plus costaud. Roger ne ménage pas ses éloges, il y va franco : « on rit presque sans interruption pendant une heure et demie », « si vous aimez l’humour new-yorkais allez voir ça ».
Si vous voulez la définition de l’humour new-yorkais, laissez tomber, Roger n’a pas le temps.
Mon quatrième est « Mam’zelle Nitouche » de Yves Allegret. Nous avons droit à une anecdote, vraie, fausse, peu importe, tant qu’elle démolit un navet.
Max Ophüls était pressenti pour le film, mais a hélas – ou heureusement – refusé. Il a indiqué Allegret pour le remplacer, ce qui fut fait. Mais hélas, Max Ophüls avait oublié de mentionner lequel : Yves ou Marc ?
D’où ces paroles conclusives de Roger : « Alors du film il n’y a pas d’autre chose à dire : on s’est trompé d’Allegret ».
Complétons cette conclusion en réparant un bête oubli. « Mam’zelle Nitouche » de Yves Allegret (1954, avec Fernandel) est le remake de « Mam’zelle Nitouche » de Marc Allegret (1931, avec Raimu).
Après sa rubrique « Les échos », dans laquelle Maurice Renault narre les techniques de marketings sauvages des maisons d’éditions américaines de romans policiers, Pierre Véry annonce la fiction de la semaine suivante, une histoire de soucoupe volante, écrite par Alexandre Rivemale et intitulée « Trabadoc et Rabalax », qui, tout comme l’histoire d’empoisonnement promise auparavant (« Musique douce » de Jacques de Beaupré) n’a pas été conservée dans les archives.