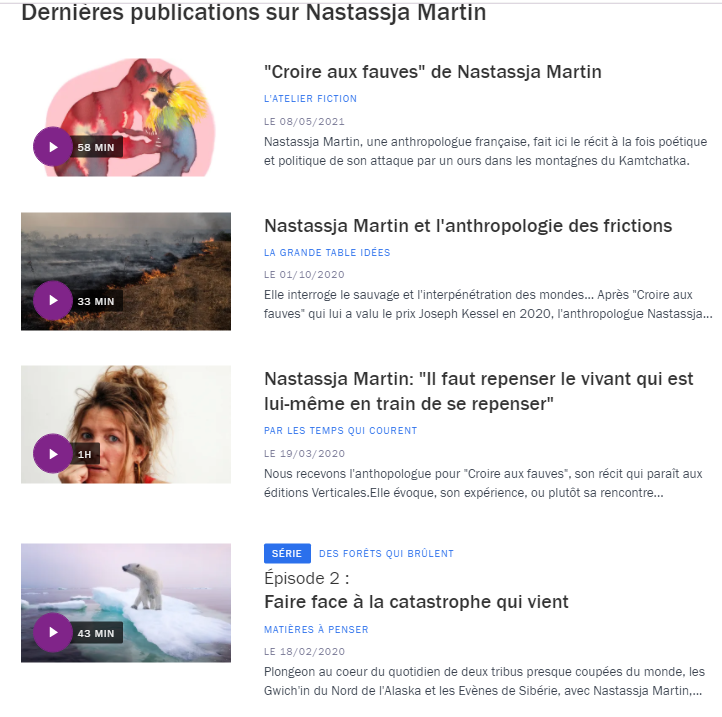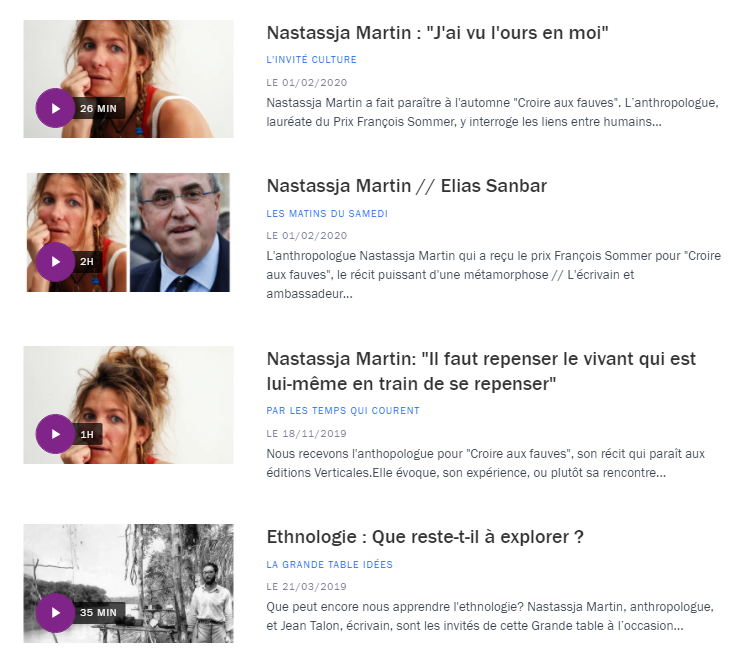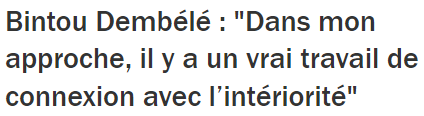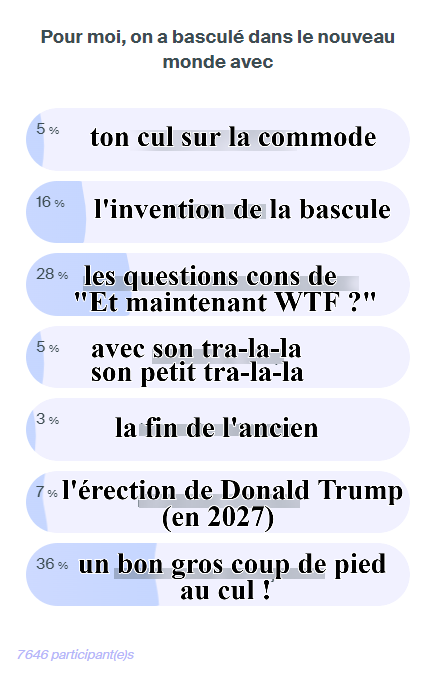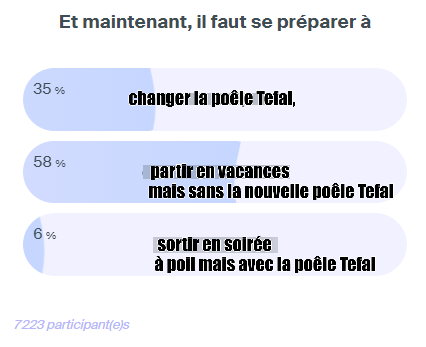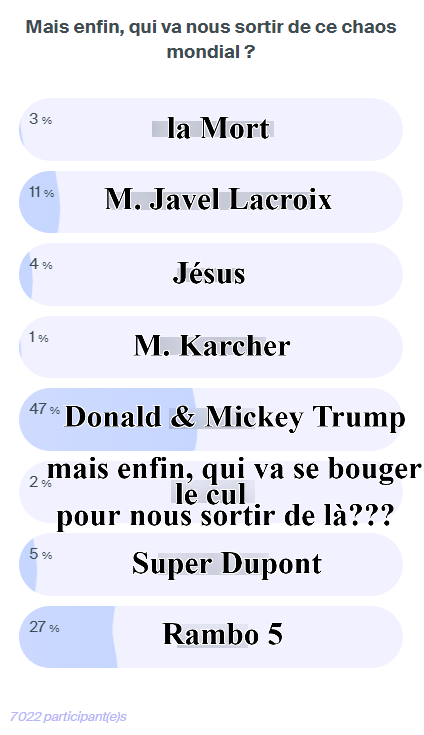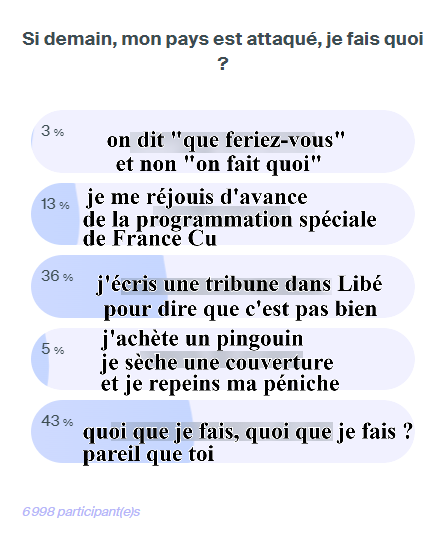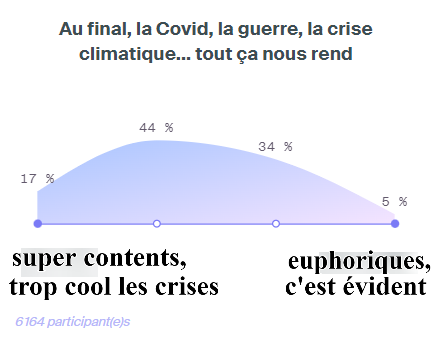Si l’on en juge le nombre d’invitations, Nastassja Martin est une penseuse majeure pas seulement du vivant en train de se repenser mais aussi du XXIème siècle.
Voyez plutôt :
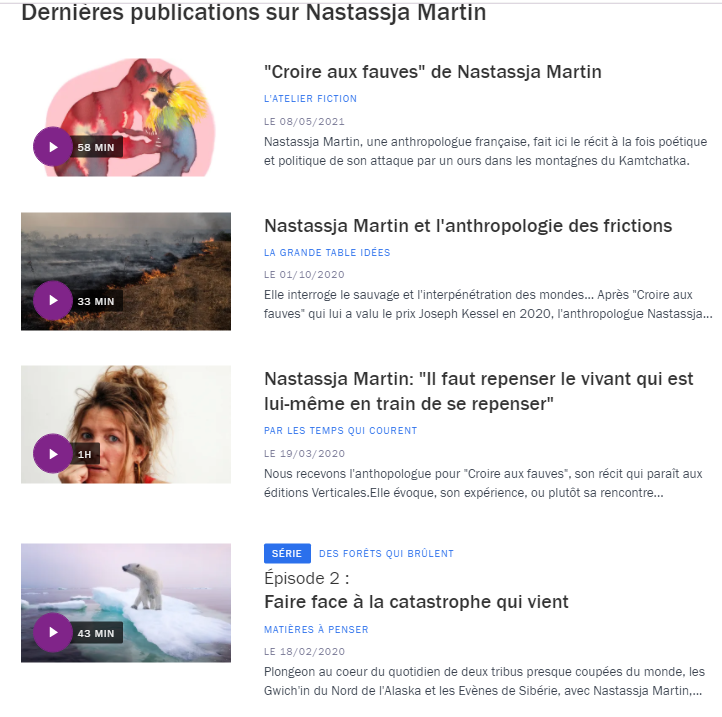
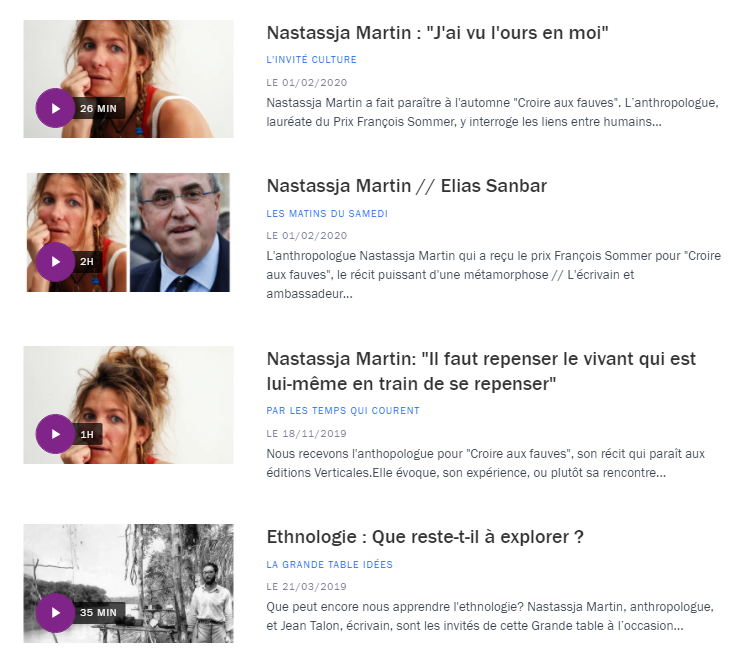

Mais revenons en haut, et à l’adaptation de son nœuvre ultra promue :
Croire aux fauves, un récit à la fois poétique et politique. Whaaaa ! Les deux pour le prix d’un, mais on fonce, allonzi !
Nous avons sacrément envie de picorer un bout de vivant dans cet atelier fiction, lecture d’extraits dits par une voix sèche, qui tente d’allier poétique et politique sans s’emmêler les pinceaux ni les cordes vocales.
1ère minute : « Car je fus longtemps garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson perdu dans la mer »
Le vivant ne fait qu’un, et si vous avez compris cette belle parole poétique, c’est que vous avez tout compris, vous n’avez plus qu’à plonger dans la poésie qui se repense. Ce n’est ni de la poésie symboliste, ni de la poésie romantique et encore moins surréaliste, mais de la poésie de l’école naïve niveau primaire. Mais après réflexion, je trouve que c’est cruel pour les écoliers du primaire. Donc pas de niveau du tout.
5ème minute : Il est temps de rappeler que l’expérience est celle de l’autrisse qui s’est fait complètement repenser par un ours dans les montagnes du Kamtchatka, et qui s’est fait conséquemment repanser à l’hosto.
« C’est une vieille femme qui ferme mes plaies. Avec une infinie précaution je la vois manier le fil et l’aiguille. Puis passé le stade de la douleur je ne sens plus rien mais je suis toujours consciente. Je n’en perds pas une goutte. Je suis lucide au-delà de mon humanité. »
Nous voyons à quel point le vivant, tout le vivant, est la principale préoccupation de la narratrisse. A quel point cette expérience intime devient universelle quelque part. Que le « je » peut devenir un « nous » à condition de ne pas plier. Jeu de mots lamentable vous conviendrez, mais il n’en est pas moins ni poétique ni politique.
Comme on cause humour, la phrase « je n’en perds pas une goutte » n’en manque pas, ou alors l’autrisse a fait exprès de ne pas faire exprès de faire une blaguounette entre deux passages au-delà de son humanité.
10ème minute : « En atteignant brutalement mon estomac la bouillie me fait hurler de douleur. L’infirmière cheffe alertée par mes cris entre dans la salle, s’approche et rabroue sa cadette qui me lance un regard assassin. Je me dis qu’elles me font payer cher ma survie de femme face à l’ours. »
Vous avez compris que l’héroïne est à l’hosto et que les infirmières la prennent pour une buse qu’a un peu cherché les emmerdes en se jetant dans la gueule de l’ours. L’héroïne de son lit observe les jeux de pouvoirs entre les Hommes, ici les infirmières. Elle partage son temps entre la réflexion et la douleur. C’est la partie politique du truc.
15ème minute : « Cela fait plusieurs jours que je demande qu’on me rende mes effets, mon téléphone surtout, pour pouvoir appeler ma famille. Sans succès. Pourtant ce jour-là l’assistant du médecin chef fait son entrée en trombe et s’avance vers mon lit: ‘’Tu connais un certain Charles ?’’ L’espoir renaît d’un coup. Mes mots s’emballent alors que je tente de lui expliquer. Charles, mon compagnon de recherche, mon ami, mon camarade au laboratoire d’anthropologie sociale. »
Vous avez le droit de ne pas trouver ce texte suffisamment poétique. Je vous l’accorde, bien que je n’en panse pas moins.
20ème minute : « Non, rien n’est sa faute. Ce qu’il a fait, il a guidé mes pas pour que j’aille au devant de mon rêve. Daria elle aussi a toujours su. Elle sait qu’il me visite quand je dors. Je lui raconte au petit matin les ours de ma nuit, familiers, hostiles, drôles, pernicieux, affectueux, inquiétants. Elle écoute en silence. »
L’inconvénient lorsque vous subissez un trauma, c’est que ça affecte votre inconscient de manière durable. Votre conscient aussi, mais ça c’est trop fastoche. Alors après le choc, c’est le cirque aux ours dans la tête de l’aventurière. C’était fatal. Admirez seulement la poésie qui fouette grave dans ce passage, comme dans les autres non reproduits ici parce que j’ai pas que ça à foutre.
25ème minute : « Les analyses post-opératoires sont bonnes. Nous nous préparons à plier bagage pour rentrer en France. Ma mère et moi passons des heures à discuter pour savoir dans quel hôpital il serait préférable que je sois transférée. »
Ce passage n’est ni politique ni poétique. Ç’aurait pu être un journal intime, mais ça ne l’est pas, parce que ça nous parle à tous à nous les vivants. Il faudrait juste, afin qu’il devienne vraiment universel, qu’il soit traduit en langage des plantes et en langage des animaux. Sûr que ça les passionnerait autant que nous.
30ème minute : « L’informe se précise, se dessine, se redéfinit tranquillement, brutalement. Désinnervée, réinnervée, mélangée, fusionnée, griffée. »
L’alliance des contraires, l’alliage savant des oppositions fait tout le sel de ce passage excessivement original. La référence finale aux griffures reste à décrypter. Poil au nez.
35ème minute : « De grosses larmes roulent sur les joues de ma mère. Je suis revenue hier, nous sommes à table, il est midi. Je ne sais pas lui annoncer autrement que d’une façon brutale. La délicatesse n’a pas toujours été mon fort.
- Je vais repartir là-bas.
- Quand ?
- Dans deux s’maines. Je suis hors infection, les radiographies sont bonnes et ne prêtent pas à confusion. »
Et nous, que ressentons-nous ? Nous pleurons avec la mère, et nous admirons le courage de notre héroïne qui en recevant l’ours en pleine poire a eu la Révélation. Le passage est violent, l’écriture est austère, mais nous avons basculé sec dans le religieux. La religion du vivant, faut pas rigoler avec. Vous la recevez de par un ours, et elle ne vous quitte plus.
40ème minute : « Je ne sais pas où je vais, peut-être nulle part. Je suis dans une tanière, et ça me suffit. Je prends la mesure de l’immensité autour et des minuscules gestes du quotidien à l’intérieur. Expression d’une patience infinie propre aux humains qui se tiennent au chaud en attendant l’explosion du printemps. »
Superbe métaphore de notre misère humaine. Après avoir été atomisée par un ours, voilà notre héroïne prête à se prendre l’explosion du printemps en pleine gueule. Quel courage.
45ème minute : « Lorsque Daria dit que les ours en me rendant saine et sauve au monde des humains leur ont fait un cadeau, l’ours et moi devenons une fois de plus l’expression d’autre chose que nous même. »
Le meilleur moyen pour qu’on gobe avec admiration son aventure extraordinaire est de faire passer son ego surdimensionné pour l’expression d’une universalité qui va parler au dedans de chacun de nous. Et voilà, le tour est joué.
50ème minute : « J’ouvre les yeux. La respiration des garçons est constante. Il fait encore nuit. Daria est allongée près de moi qui m’observe, les yeux ouverts.
- Tu as rêvé, elle chuchote.
- Oui.
- Qu’as-tu vu cette fois ?
- Des chevaux. Des centaines de chevaux dans la neige.
- Bien, elle dit. Les chevaux, c’est toujours bon signe. Ils ne sont pas loin. Ils te parlent.
- Ils n’ont rien dit, je réponds.
- Ce n’est pas avec des mots qu’ils parlent, parce que tu ne les auraient pas compris. Si tu les a vus, c’est qu’ils te parlent. »
La symbolique des rêves est un puits poétique sans fond. Notre aventurière de l’extrême progresse, elle ne se contente plus des ours, il lui faut aussi des dadas.
Décryptons les symboles : c’est la symbiose avec la nature (les ch’vaux, la neige), et la communion avec icelle.
Le point info : les animaux ne parlent pas, ils vont pas vous réciter l’appel du 18 juin comme ça, sans filet, en français. Les animaux, ça parle pas avec des mots à nous, bien que ça communique quand même. Vous m’encadrez ça en rouge svp, c’est super important, vous me l’apprenez pour la prochaine fois.
55ème minute : « Je marche sur ce plateau d’altitude aride sur lequel je n’ai à priori rien à faire. Je sors du glacier. Je descends du volcan. Derrière moi la fumée créé (sic) un halo de nuages. Je m’imagine seule, pour toute les raisons personnelles, historiques et sociales que l’on sait. Mais pourtant je ne le suis pas. Un ours, tout aussi déboussolé que moi se promène lui aussi sur ces hauteurs, où il n’a rien à faire non plus. Il est presque comme un alpiniste alors. C’est vrai, que fait-il là ? (…) Alors qu’il pourrait être en pleine forêt en train de pêcher. Nous tombons l’un sur l’autre. Si le kairos doit avoir une dimension, c’est celle-ci. »
A quoi voit-on que nous arrivons à la fin de cette aventure spirituelle quoique physique aussi quand même ? A ce que notre aventurière de l’extrême ne se fait plus fracasser par l’ours, mais ne fait presque (je dis bien presque) plus qu’un avec l’ours, avec la nature, parce qu’enfin elle a découvert qu’elle en faisait partie ! Alléluia !
Le vivant qui se repense a été enfin repensé !
 ) en 1985 [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/15537-05.02.2021-ITEMA_22565064-2021C23850S0036.mp3" debut="21:18" fin="24:40"]
) en 1985 [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/15537-05.02.2021-ITEMA_22565064-2021C23850S0036.mp3" debut="21:18" fin="24:40"] ) en 1985 [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/15537-05.02.2021-ITEMA_22565064-2021C23850S0036.mp3" debut="21:18" fin="24:40"]
) en 1985 [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/15537-05.02.2021-ITEMA_22565064-2021C23850S0036.mp3" debut="21:18" fin="24:40"]